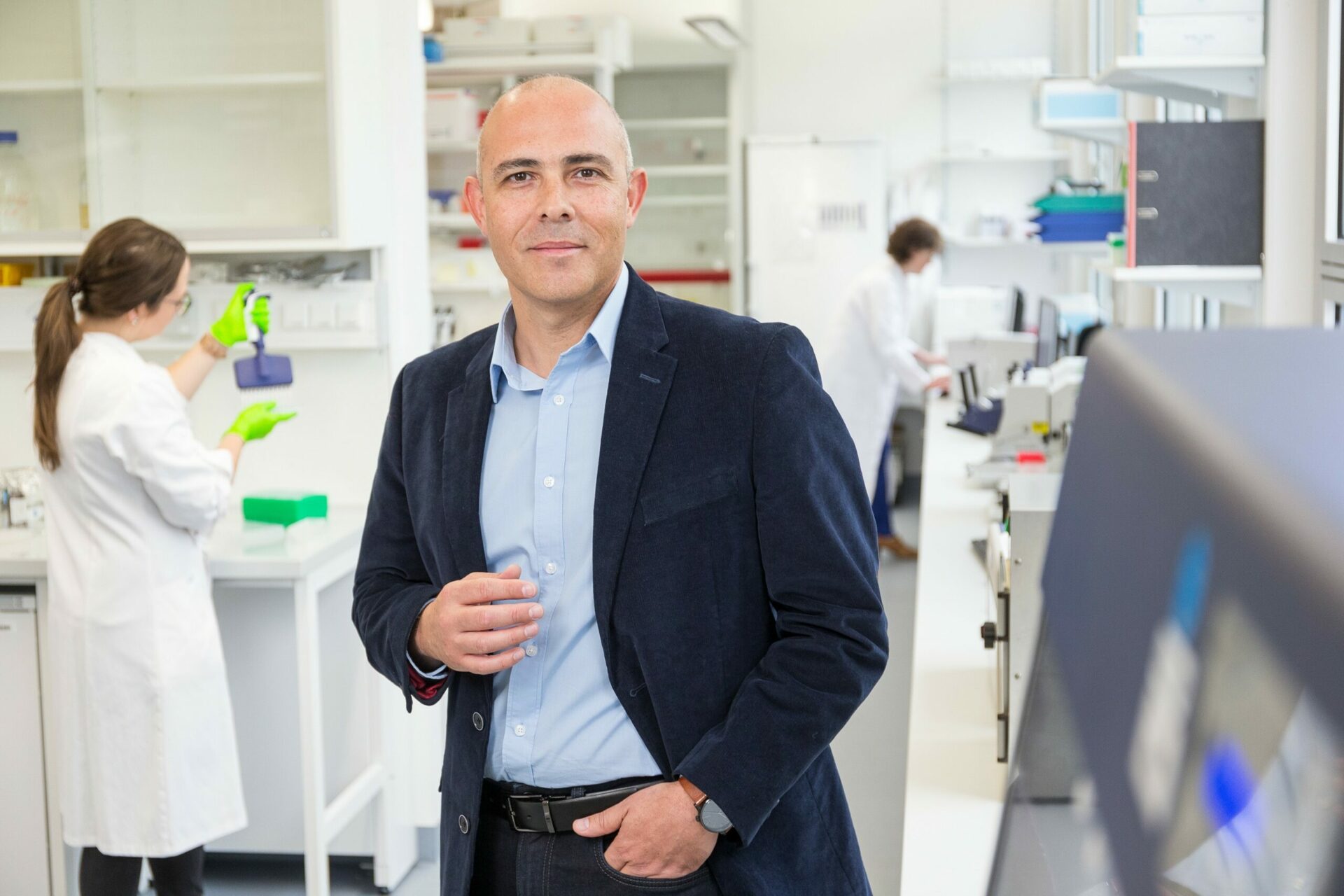En novembre 2021, la Fondation Azrieli et l’Institut Weizmann des sciences ont annoncé la création de l’Institut Azrieli pour le cerveau et les neurosciences.
Avec un don principal de 50 millions $ US de la Fondation, le campus de Rehovot de l’Institut Weizmann, en Israël, accueillera son nouvel institut phare de recherche en neurosciences, qui sera hébergé dans un tout nouveau bâtiment à la fine pointe de la technologie. Il s’agit du plus récent chapitre du partenariat à long terme entre la Fondation Azrieli et l’Institut Weizmann. Auparavant, la Fondation avait déjà versé près de 30 millions $ US pour une foule de projets de recherche, d’installations et de bourses de recherche.
Le professeur Alon Chen, président de l’Institut Weizmann des sciences est lui-même un neuroscientifique qui se spécialise dans la neurobiologie du stress. Nous nous sommes entretenus avec lui au sujet de cette nouvelle initiative et de sa vision pour l’avenir.
Fondation Azrieli : Cela fait un an depuis l’annonce de la création de l’Institut Azrieli pour le cerveau et les neurosciences. Pourriez-vous nous partager les dernières nouvelles?
Alon Chen : Nous venons de connaître une année extraordinaire au niveau de la collecte de fonds pour cet important projet. Nous avons déjà amassé 91 % des coûts de construction du bâtiment, et les travaux devraient commencer comme prévu en juillet ou en août 2023. Dans le domaine du cerveau et des neurosciences, les besoins médicaux sont immenses, et il s’agit d’un système extrêmement complexe. C’est la raison pour laquelle ce fut relativement facile de rallier la communauté mondiale autour de ce projet.
Nous avons également apporté des changements structuraux afin de nous préparer pour le lancement du programme d’études, en répartissant la quarantaine de groupes de recherches en neurosciences en deux entités : le département des sciences du cerveau et le département des neurosciences moléculaires. Cela renforcera les capacités de l’Institut Azrieli.
FA : L’annonce met l’accent sur les interfaces créatives qui peuvent émerger lorsque des scientifiques de différentes disciplines travaillent sous le même toit. Pourriez-vous nous donner un exemple tiré de vos propres recherches, dans lequel cette proximité physique avec des scientifiques ayant d’autres domaines d’expertise a eu un impact?
AC : Nos scientifiques ont la liberté d’explorer, ce qui est particulièrement important en neurosciences; en effet, il s’agit d’un domaine réellement multidisciplinaire, où l’on mise sur l’expertise de personnes issues de la sphère biomédicale, mais aussi des domaines de la physique, des mathématiques, de l’informatique et de la psychologie, entre autres. Si je pense à ma propre expérience liée aux neurosciences biomédicales, je peux vous donner deux exemples.
Mon laboratoire étudie les réactions du cerveau aux stimuli déclencheurs de stress, et leurs liens à différentes psychopathologies, ce envers quoi nous recueillons une foule de données comportementales et physiologiques. Grâce à notre collaboration avec le laboratoire du professeur Elad Schneiderman, nous avons pu établir des modèles mathématiques permettant de tirer des conclusions à partir de la grande quantité de données que nous produisons. Nous sommes parvenus à développer une approche nettement plus sophistiquée et à faire en sorte que l’étape de la recherche préclinique auprès d’animaux se rapproche davantage de la pathologie humaine. Cela n’aurait jamais été possible si Elad et moi ne nous étions pas croisés dans le couloir et si nous n’avions pas mangé un bout ou pris un café ensemble pour discuter de ces concepts, ce qui est exactement ce que nous avons fait.
Le deuxième exemple, qui est plus bref, concerne la collaboration avec des cliniciens –dans mon cas, des psychiatres. La perspective clinique a complètement changé la manière dont nous abordons certaines questions. Les données humaines et cliniques nous permettent d’élargir la portée du type de science que nous pratiquons.
FA : L’institut Weizmann a une vision très claire de la « science pour le bienfait de l’humanité », et votre excellence en matière de recherche fondamentale est reconnue à travers le monde. Comment vous y prenez-vous pour convertir vos découvertes scientifiques en savoirs qui peuvent profiter au plus grand nombre?
AC : Nous nous entendons tous sur l’importance de trouver des solutions à la maladie d’Alzheimer ou à la SLA, mais notre approche ne vise pas l’élaboration d’un traitement en tant que tel. Notre objectif est de développer des solutions découlant d’une compréhension approfondie des mécanismes des systèmes. C’est une approche qui s’avère fructueuse depuis près de 90 ans. Cela peut prendre deux ou trois décennies avant de voir un impact, mais à un moment donné, on fait des pas de géant en matière de savoirs qui bénéficient à l’humanité.
FA : Vous avez été nommé président de l’Institut Weizmann en décembre 2019, quelques mois à peine avant que les effets de la pandémie se fassent sentir à l’échelle mondiale. Comment ces événements ont-ils affecté votre vision de ce que vous vouliez accomplir à l’Institut?
AC : Le Weizmann n’a jamais réellement cessé ses opérations. Malgré toutes les restrictions, nous avons continué notre travail scientifique, même si nous devions à l’occasion réduire grandement le nombre de personnes sur le campus pour assurer la santé de chacun. La pandémie n’a pas altéré ma vision scientifique, mais elle a aidé à la façonner en partie, dans le sens que le public, les décideurs politiques et les politiciens ont compris qu’il revenait aux sciences de trouver la solution, et que l’on devrait activement promouvoir les sciences sur la scène mondiale. La COVID représente un événement profondément regrettable, il va sans dire, mais ce qui s’est passé au cours de ces dernières années nous a placés dans une position qui nous permettra de promouvoir encore davantage notre vision scientifique de l’Institut.
Au début de la pandémie, nous n’avions que deux groupes de recherche étudiant les virus; en l’espace de deux ou trois semaines, nos scientifiques ont lancé plus de 60 projets de recherche sur la COVID, ce qui représente 25 % de toute la recherche menée sur le campus. Ce n’est pas parce que nous leur avons demandé, mais parce qu’ils étaient libres de faire ce qu’ils estimaient important, et ils ont simplement décidé de participer. C’est en réponse aux initiatives de nos scientifiques que nous avons créé un fonds de recherche sur la COVID, auquel ont contribué nos supporteurs à travers le monde et ce, en l’espace de quelques semaines. Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli au cours de ces deux ans et demi.
FA : À titre de président, une de vos premières visites officielles au eu lieu au Canada en février 2020. Pourquoi avez-vous souhaité faire du Canada une de vos premières destinations dans votre nouveau rôle? Et comment envisagez-vous la collaboration future entre les établissements israéliens et canadiens?
AC : Il existe au Canada une solide communauté d’amis de l’Institut Weizmann, ce qui m’a incité à m’y rendre pour promouvoir ma vision scientifique dès les premiers mois de ma présidence. Susan Stern, PDG de Weizmann Canada, fait un travail remarquable pour bâtir et développer ces relations. Nous avons également une relation de longue date avec la Fondation Azrieli au Canada – comme vous le savez, il ne s’agit pas de leur premier don. [Parmi les autres bénéficiaires d’investissements de la Fondation envers le Weizmann, mentionnons l’Institut Azrieli de biologie des systèmes, l’Institut national Azrieli d’imagerie et de recherche cérébrale, et un don majeur envers la recherche sur l’X fragile.]
Plusieurs de nos scientifiques collaborent depuis longtemps avec leurs homologues canadiens, et nous nous efforçons d’accroître ces collaborations autant que possible. Récemment, une importante délégation de présidents d’universités canadiennes est venue visiter différents établissements et universités israéliens, y compris l’Institut Weizmann. La Fondation Azrieli était l’un des parrains de cette visite. Je suis déjà en contact avec plusieurs de ces présidents d’universités afin de mettre sur pied des partenariats futurs.
FA : La Fondation Azrieli, Weizmann Canada et l’Institut Weizmann des sciences ont une relation spéciale depuis plusieurs années déjà. Qu’est-ce qui fait de cette relation un partenariat philanthropique efficace?
AC : Un alliage de confiance, d’objectifs et de vision. Je crois que l’Institut Weizmann et la Fondation Azrieli abordent les sciences de manières très similaires : par la recherche ancrée dans la curiosité, la liberté universitaire et l’accent sur l’excellence scientifique.
Il est facile de travailler avec des gens qui se passionnent pour les sciences, et cette passion est très palpable dans toutes mes conversations avec l’équipe de la Fondation Azrieli. Leur passion pour les neurosciences est très forte – pour moi, c’est facile, puisque je suis neuroscientifique –, mais il est clair pour nous qu’il s’agit de l’ultime frontière en matière de recherche biomédicale. Nous arriverons à des solutions uniquement par une compréhension des fondements de cette machine complexe, en réunissant les plus brillants esprits issus de différents domaines de recherche, et en leur offrant les ressources et le cadre appropriés afin de produire ensemble de nouveaux savoirs. Notre campus est très enthousiaste à l’idée de cette initiative.
Quant à la création de l’Institut Azrieli pour le cerveau et les neurosciences, il va sans dire qu’un tel don visionnaire créera un élan, servira d’inspiration pour d’autres et haussera la barre en matière de dons futurs.
Cet entretien a été condensé en raison de sa longueur et pour en assurer la clarté.